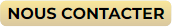Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 22-12.829 – Cassation partielle
Le 5 février 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant en matière de contribution aux charges du mariage.
Sous le régime de la séparation de biens, elle précise qu’un époux ne peut prétendre à une créance pour excès contributif en se fondant exclusivement sur le financement des travaux du logement familial.
Cette décision clarifie la frontière entre la solidarité conjugale et le raisonnement comptable souvent adopté lors des liquidations de régimes séparatistes.
Les faits : un divorce sous le régime de la séparation de biens
Mme [S] et M. [C] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Au moment du divorce, la question de la répartition des dépenses effectuées pendant le mariage s’est posée.
L’époux affirmait avoir financé seul ou majoritairement les travaux du logement familial, pour un montant supérieur à sa part de revenus.
Il réclamait donc une créance de 267 241 € au titre d’un prétendu excès contributif aux charges du mariage.
La cour d’appel de Rennes lui avait donné raison, estimant que ses revenus représentaient environ un tiers du total du couple, et qu’il avait contribué bien au-delà de cette proportion dans le financement de la maison.
Le principe : une contribution proportionnelle aux facultés respectives
L’article 214 du Code civil prévoit que, sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage, « les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ».
Cette règle s’applique même sous le régime de la séparation de biens.
Elle vise à garantir une équité globale dans la répartition des charges du ménage : logement, alimentation, éducation des enfants, loisirs, etc.
Mais l’article ne transforme pas cette contribution en mécanisme de compensation patrimoniale : il ne s’agit pas de solder des comptes, mais d’assurer la solidarité conjugale.
La position de la cour d’appel :
Les juges rennais avaient raisonné de manière strictement comptable.
Constatant que le mari avait financé la majorité des travaux de la maison, ils en avaient déduit un surfinancement, équivalent à un excès de contribution.
Or, la cour d’appel avait aussi constaté que l’épouse finançait l’intégralité des dépenses courantes du ménage : alimentation, entretien, vêtements, vacances, etc.
En négligeant cet élément essentiel, elle a violé la logique de l’article 214 du Code civil, qui impose de tenir compte de toutes les charges du mariage, et non d’un poste isolé.
La position de la Cour de cassation : une analyse globale et équitable
La Cour casse partiellement l’arrêt d’appel et rappelle avec clarté :
« L’excès contributif ne pouvait être caractérisé en considération exclusive du financement des travaux réalisés dans le logement familial. »
Autrement dit, pour apprécier si un époux a “trop contribué” aux charges du mariage, il faut examiner l’ensemble des dépenses du couple sur l’ensemble de la durée du mariage, et non seulement le poste “logement”.
Cette approche globale protège l’équilibre conjugal :
un conjoint peut financer le logement pendant que l’autre assume le quotidien, sans que l’un devienne créancier de l’autre au moment du divorce.
Une protection bienvenue pour les conjoints économiquement exposés
Cet arrêt a une portée symbolique forte, notamment pour les femmes qui, dans beaucoup de foyers, assurent les dépenses courantes ou la charge domestique pendant que leur conjoint se charge du remboursement du crédit immobilier.
La Cour redonne ici sa valeur au travail invisible et aux charges du quotidien, souvent négligées dans les comptes de liquidation.
Le fait d’assumer la vie courante du ménage — parfois sans patrimoine propre — participe pleinement à la contribution aux charges du mariage.
Ainsi, un époux ne peut pas obtenir remboursement de ses travaux sur le logement familial s’il n’est pas démontré qu’il a globalement excédé sa part contributive, en tenant compte de toutes les dépenses et de l’industrie personnelle de chacun.
Conséquences pratiques pour les praticiens et justiciables
Pour les avocats et notaires chargés de liquider un régime de séparation de biens, cette décision impose une vigilance accrue :
- Éviter les raisonnements comptables simplistes : il faut apprécier la contribution globale, sur la durée entière du mariage.
- Valoriser les dépenses courantes et la contribution domestique : l’achat de denrées, la gestion du foyer, la garde des enfants sont aussi des formes de participation.
- Évaluer les facultés contributives dans le temps : les revenus peuvent évoluer, et la contribution doit être proportionnée sur la durée, non à un instant donné.
En somme, la solidarité conjugale ne se réduit pas à un rapport d’équations financières.
FAQ – Contribution aux charges du mariage
1. Qu’est-ce qu’un “excès contributif” ?
C’est la situation dans laquelle un époux a contribué aux charges du mariage au-delà de ce que ses revenus justifiaient. Il peut alors réclamer une compensation, mais seulement si cet excès est prouvé sur l’ensemble des charges du mariage.
2. Le remboursement du prêt immobilier suffit-il à prouver un excès contributif ?
Non. Le financement du logement familial n’est qu’un élément parmi d’autres. Il faut prendre en compte toutes les dépenses du couple.
3. Une épouse qui paye les dépenses courantes peut-elle être considérée comme ayant contribué suffisamment ?
Oui. Le paiement des charges quotidiennes (alimentation, éducation, loisirs) participe pleinement à la contribution aux charges du mariage.
4. Que risque un époux qui demande un remboursement fondé uniquement sur les travaux du logement ?
Sa demande peut être rejetée, faute de démontrer que la contribution globale de l’autre conjoint a été insuffisante.
Conclusion – Une approche plus juste et réaliste du couple
En refusant de réduire la contribution aux charges du mariage à une simple équation comptable, la Cour de cassation replace cette notion dans sa dimension humaine et solidaire.
L’arrêt du 5 février 2025 protège l’équilibre entre les époux et rappelle que le mariage ne se résume pas à un bilan financier, mais à un engagement de partage global des charges et des responsabilités.
Référence : Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 22-12.829
Rédaction : Cabinet DCM Avocats – Cannes